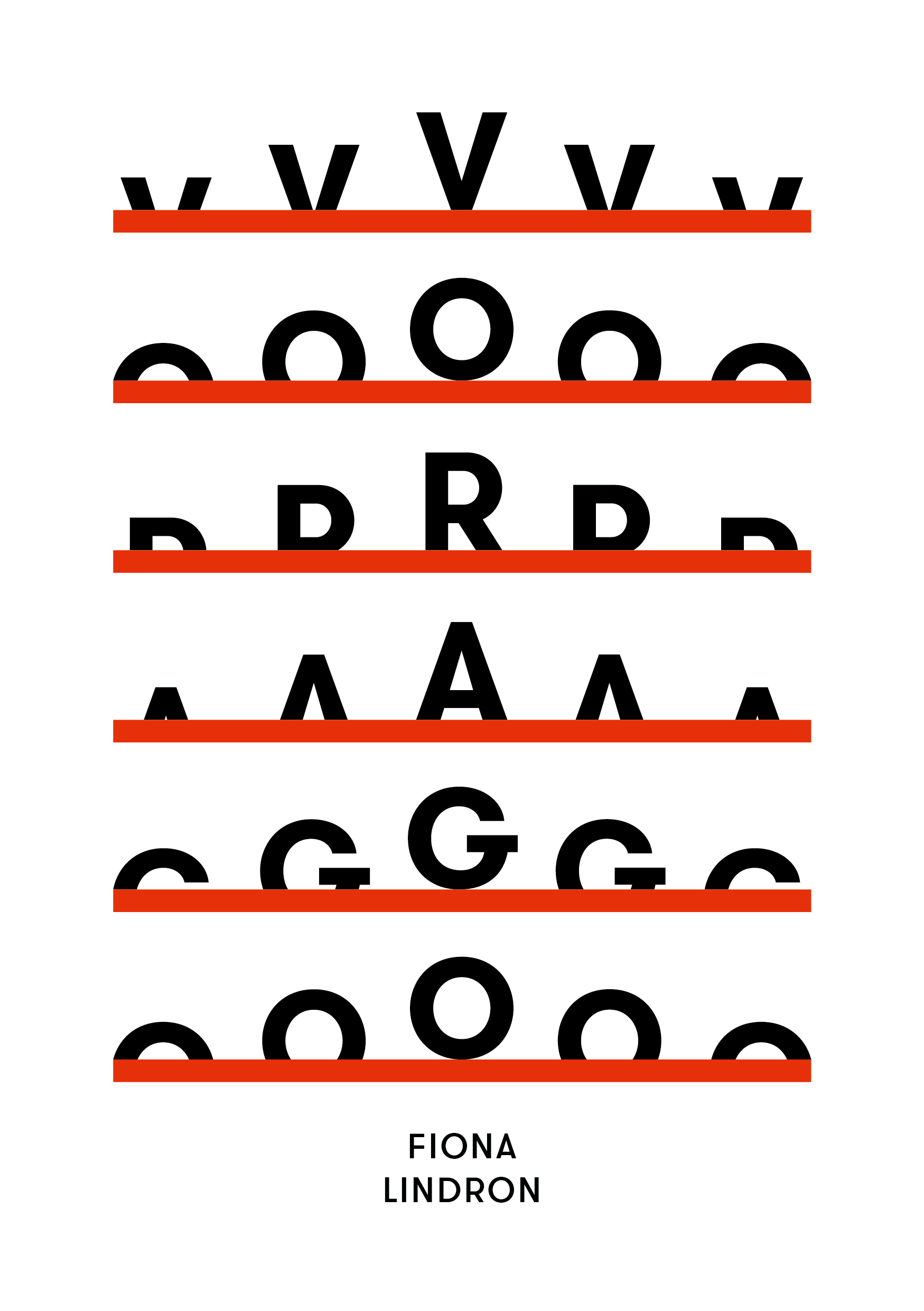vorago
Exposition
9 juin – 30 juin 2017
> Fiona Lindron <
artiste invitée :
> Julia Kremer <
Situations
« Je rêve aux images élémentaires, aux rêves que d’autres en d’autres situations, d’autres temps et lieux, en des corps différents surtout… ont pu avoir. Leurs images de base, fondements de leur tempérament, répondant à leurs faims, leurs besoins, leurs penchants, si je pouvais les voir… » Henri Michaux, Poteaux d’angles, 1971.
A l’image projetée contre le mur, apparaît le visage d’un homme noir, le regard face caméra vers l’œil qui l’observe. Ce portrait mobile, émergeant aujourd’hui au sein d’une vidéo de l’installation Vorago, rappelle une autre figure, celle d’un homme, le visage sombre et émacié écartant les plantes sur son passage, le regard est tourné vers celui qui le filme et déclare : « Ce pourrait être Oreste ». Dans son Carnet de notes pour une Orestie africaine, Pier Paolo Pasolini, met en scène ses recherches pour adapter l’Orestie dans l’Afrique des années soixante, utilise ainsi le mythe pour toucher à l’actualité géopolitique d’un continent. Fiona Lindron dans Vorago, entame ici le processus inverse. Le réel historique devient le point de départ dont il faut s’abstraire pour rejoindre le mythe. Vorago trouve alors son origine dans la révolte des mineurs espagnols dans les Asturies en 2012, mais au-delà de cette actualité politique c’est l’idée même de révolte qui nourrit le travail de l’artiste. Vorago n’est pas une œuvre documentaire s’il s’agit de toucher objectivement aux faits, d’en conserver les traces les plus exactes. Au contraire Vorago rejoue le questionnement anthropologique en le décalant par l’usage de la fiction. Les éléments de l’installation, les trois vidéos, les volumes ainsi que les deux photographies ont été créés pour faire fiction, c’est-à-dire pour rejouer et par là même, s’approprier les mécanismes de l’évènement réel. Cette référence à la situation première que l’œuvre entend approcher est ici effacée par Fiona Lindron. Décor qui pourrait être cent lieux à la fois, acteurs choisis dans le cercle des rencontres, dialogues absents, tout est ouvert à l’interprétation et porte à l’universalité du mythe.
En exergue de l’installation, au pied de l’escalier qui conduit au déploiement de Vorago dans l’espace d’exposition, Fiona Lindron invite aujourd’hui Julia Kremer. Son œuvre est un trompe l’œil ou plutôt la mise en abîme d’un mur sur le mur d’origine. Un mur peut en cacher un autre, le mur est un motif classique de l’imaginaire guerrier et géopolitique, le mur est un corps social articulé de briques. Julia Kremer utilise la photocopieuse, agrandit à l’infini des images de murs volants en éclats pour en construire un seul, visible dans le temps suspendu de son explosion. Le mur de Julia Kremer joue avec les questions d’échelle, avec ce que l’on voit de près, ce que l’on comprend de loin. Le regard oscille entre l’unité des points formant le grain des images imprimées et la fresque que l’œil englobe si le corps s’éloigne de la surface. Ce passage de l’unité au multiple, de l’individu au corps social, est un ressort de compréhension du politique conçu comme vivre ensemble. Le lien entre le travail de Fiona Lindron et de Julia Kremer est donc étroit. Si pour Vorago, Fiona Lindron a choisi d’embrasser plusieurs médiums, le diptyque photographique est le point évident de ce mouvement de l’individu au collectif. L’artiste place symboliquement en regard une figure ouvrière à celle d’un révolté encagoulé. C’est le basculement d’une position à l’autre qui peut devenir le fil rouge de l’histoire. De même les volumes, évoquent également ce basculement : d’une colline de charbon à un faisceau de fumigènes artisanaux. Comment naît la révolte ? Comment le minier devient-il un insurgé ? Avec Hiberna, Fiona Lindron réalise déjà une fiction sur la résistance en cavale dans les forêts de Sologne, sans que jamais la situation ne soit explicite. Des tireurs en blousons noirs avancent dans la brume, on pense au cinéma des années soixante-dix, Tarkovski, Kubrick, Pasolini en tête. Vidéo présentée en double écran comme des peintures en diptyque, Hiberna montre des personnages qui tirent face caméra, contre le spectateur. Ces visages isolés en gros plan sont récurrents dans la production de Fiona Lindron, dans Hiberna, dans Vorago, mais aussi dans 520 days, qui relate le voyage de l’artiste sur un thonier des Seychelles. Ces portraits en mouvement, aux regards directs, questionnent le collectif. Il y a d’abord, le groupe humain qui est toujours filmé entre solitude et solidarité. Dans Hiberna, ce sont des résistants qui marchent en forêt d’un pas semblable tout en se visant mutuellement de leurs armes bigarrées. Dans Vorago, ce sont les révoltés muets qui préparent ensemble des cocktails Molotov. Dans 520 days, le sentiment de cohésion de l’équipage s’érode sous l’immense isolement de chacun. L’homme serait-il un loup pour l’homme ? Dans cette extériorité du regard qui filme ou qui regarde le film, c’est aussi l’enjeu du rapport du collectif à celui qui n’en fait pas partie qui se joue. Le spectateur en hors champ est celui qui accompagne, celui qui juge l’action de ceux qui tentent de survivre au sein de la situation. Ainsi le travail vidéo de Fiona Lindron prend toujours place dans l’espace de la salle d’exposition plutôt que dans le dispositif de la salle de cinéma, parce qu’il y a le corps du spectateur. Par sa vision parcellaire incapable d’embrasser tous les écrans du diptyque ou du triptyque, par son déplacement imprévisible, ce corps là compte pour faire œuvre et donc créer une situation, reprenant les implications de la situation historique de départ. Comme dans la vie, chacun est ici engagé, non pas au sens clôt de la militance, du camp que l’on choisit ou pas, mais plutôt au sens sartrien, où tout le monde est embarqué quoiqu’il fasse, où le retrait du monde est encore une manière d’être au monde, où tout un chacun est un fragment du tout. Vorago en latin désigne l’abîme, le tourbillon violent contre lequel on ne peut rien et dans lequel on est vivant, souffrant, prêt à éprouver mille espoirs contraires.
Florence Andoka
Julia Kremer vit et travaille à Bruxelles.
En prenant comme point de départ la photocopie, pour laquelle il suffit (en principe) d’appuyer sur le bouton, Julia Kremer va trouver le moyen d’utiliser tout ce que la machine lui met à disposition pour recomposer par éclatement, une image.
Elle nourrit sa photocopieuse noir et blanc de tout ce qui lui passe sous la main, les matières et les possibles lui semblent inépuisables.
En déchirant, assemblant, scotchant et collant tous les A3 qui sortent de sa photocopieuse, elle construit des images de deux mètres de haut minimum tel des grandes portes ouvertes sur un monde imaginaire composé des restes du nôtre.
Il n’y a pas de machine neutre. Elles produisent toutes des objets qui déterminent notre regard, Julia Kremer utilise la photocopieuse comme un outil de production dont l’histoire administrative devient un prétexte pour nous plonger dans des paysages mystérieux fait de grain et de bruit.
> Télécharger le communiqué de presse <
Photographies: © Cécilia Philippe, 2017, © Steph Bloch, 2017