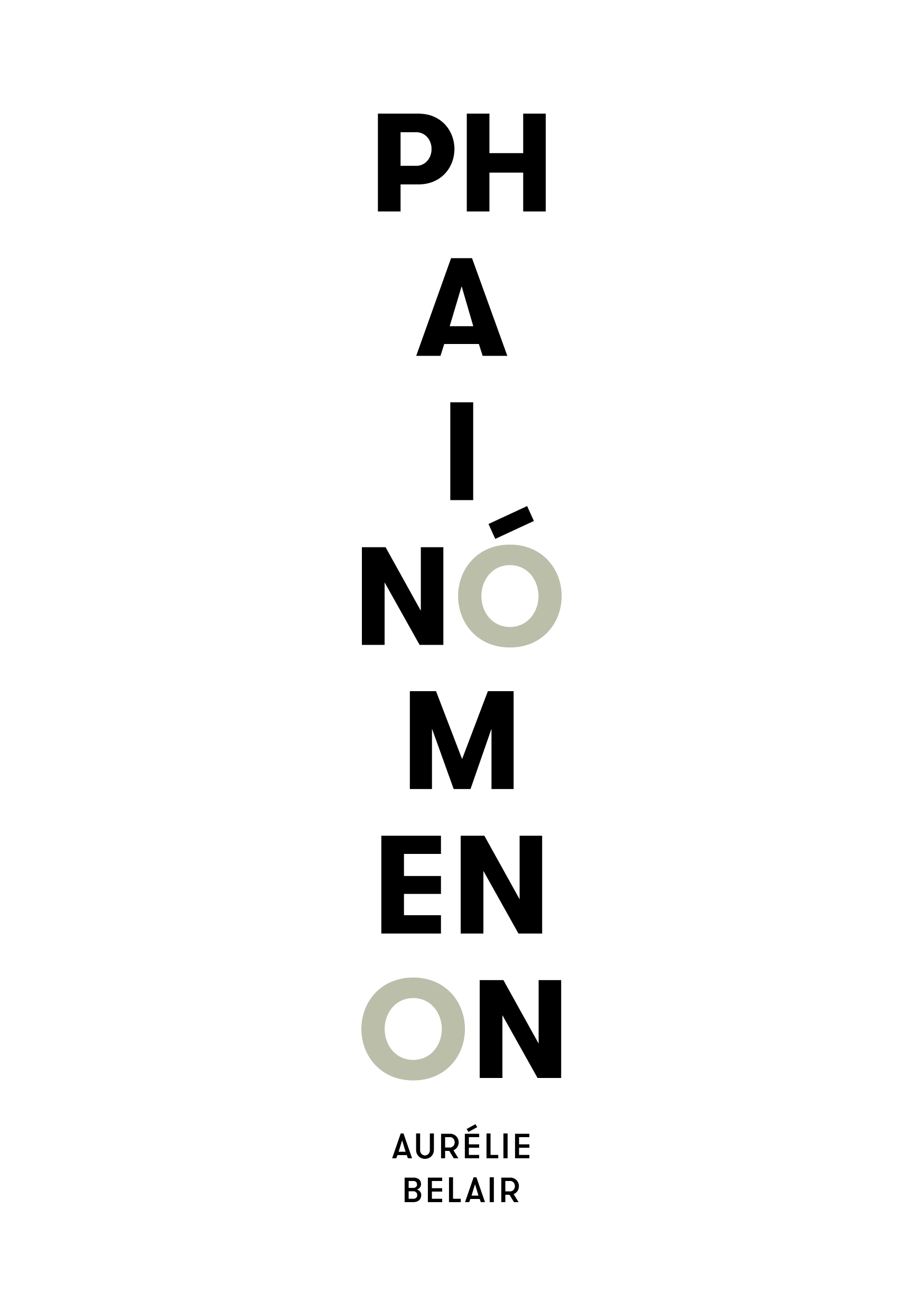PHAINÓMENON
Exposition
8 – 30 juin 2018
> Aurélie Belair <
« Cette volonté moderne d’éclaircir et de tout expliquer me fatigue. Je ne dis pas qu’il faut maintenir un obscurantisme complet, mais l’ombre a des qualités d’éclairage tout aussi intéressantes que les grandes baies vitrées du modernisme. Nous avons besoin de zones d’ombre. »
Jean-Luc Moulène
Il n’y a ni eau ni électricité dans l’atelier qu’occupe Aurélie Belair, quai de Mantoue, à Nevers. Au-dessus d’un vestibule qui lui sert de stockage, on accède à son espace de travail par un escalier étroit. Les murs sont peints en blanc, le sol est recouvert d’un palimpseste grisâtre et depuis deux fenêtres, on voit la Loire, le béton de la maison de la culture, quelques arbres, le skatepark et le pont qui mène les voitures au sud de la ville. C’est aussi de ces fenêtres que pénètre cette lumière grise caractéristique du ciel neversois. Une lumière presque monochrome, dont la teinte pâle alourdit l’horizon des jours, parfois des semaines voire des mois, et qui avale tout dans son épaisseur humide comme surgie du fleuve. Il faut l’imaginer, cette lumière, s’infiltrer dans la matière même des murs et du sol de cet atelier, à la surface des étagères soigneusement organisées, nimber les images punaisées ça et là et mettre fébrilement au jour, dans leurs différents états d’achèvement, les productions qui en émergent.
Il me semble avoir toujours perçu, dans les pièces d’Aurélie Belair que j’ai pu découvrir entre ces murs, l’expression d’un questionnement du langage. Je me souviens de toiles recouvertes d’aplats doux, presque atmosphériques et parfois légèrement dégradés, où se répandait un dense réseau de lignes blanches. La forme dynamique des traits évoquait un engagement du corps dans ces trames enchevêtrées tandis que le titre de la série, Vocabulary (2014), laissait entendre que quelque chose pouvait être ici à démêler, à défaut d’être lu. Un autre ensemble d’œuvres intitulé Speech Less (2015), employant une gamme chromatique plus vive, et traduisant un geste agressif et tranché, affirmait de manière directe le caractère silencieux, pour ne pas dire mutique, de ces peintures. S’il était ainsi question de langage à travers ces deux exemples, ce n’était pas tant pour nous conduire dans la linéarité d’un propos signifiant que dans le chaos de signes orphelins de référents, rendus à une matérialité exacerbant l’expérimentation picturale. Vocabulary et Speech Less inauguraient alors une recherche paradoxale, associant à l’enténèbrement progressif du discours l’apparition de plus en plus claire d’une syntaxe propre à la peinture, devenue la seule structure cohérente à-même de véhiculer l’ensemble de ce que l’artiste accepterait désormais de nous dire.
Un des ressorts actuels de la pratique d’Aurélie Belair se situerait donc dans une attitude qui apparait alternativement opacifiante et éclairante : les œuvres se caractérisent par une certaine simplicité formelle – empruntant même les aspects rudimentaires d’objets rituels ou primitifs – qui dissimule en son sein les actes prévalant à leurs réalisations. La série des Amulet (2018) dressée dans l’espace des Ateliers Vortex convoque un imaginaire multiple : sorte de mâts autonomes ou de totems étroits, elle poursuit parallèlement une histoire de l’installation minimale « affectée », dont les racines la lie autant aux environnements feutrés de Joseph Beuys qu’aux sculptures quasi organiques de Lygia Clark ou d’Eva Hesse. En rythmant spatialement la déambulation du visiteur à travers elles, les Amulet entretiennent non seulement un dialogue essentiel avec le lieu de leur présentation mais figurent les conditions singulières de leur élévations – les nœuds successifs qui les composent traduisant le rôle de la main et l’implication du corps dans la torsion des matériaux. Ce « paysage » vertical, comme se plait à le qualifier l’artiste, incarne dès lors une somme de temps unifiée, où le geste plastique résonne avec la production de rites qui accueilleraient la répétition pour son potentiel obsédant, presque aliénant : l’alibi d’un dépassement de soi qui conduirait à une transe douce.
À l’entrée de l’exposition, Aurélie Belair a installé une vidéo dont le titre, M. qui défait des nœuds (2018), semblent directement faire écho à ces colonnes de tissu installées à l’étage. Les mains qui nouaient sont ici celles qui libèrent et s’accordent harmonieusement entre elles, dans une chorégraphie fluide, hypnotique. Balayant la blancheur immaculée de l’écran, vues légèrement de dessous – accentuant de fait leur emprise réelle et symbolique – ces mains sont celles de Muriel, magnétiseuse en exercice. On retrouve cette inclinaison thérapeutique et occulte dans la toile Sans titre – dialectique des hiérophanies (2018) : le châssis circulaire d’une toile de coton vierge est perforé de multiples clous et de vis, composant un anneau hérissé et métallique se détachant des cimaises. Installée in situ aux Ateliers Vortex, l’oeuvre référe aux statuettes guérisseuse Minkisi, que les sorciers au bord du fleuve Kongo transpercent d’objets tranchants au cours de cérémonies destinées à soulager leurs patients. L’œuvre réemploie les systèmes d’accrochages de la peinture afin d’agir à sa surface même, comme pour lui invoquer un pouvoir protecteur.
Une des ambitions de la modernité, comme le souligne Jean-Luc Moulène dans l’extrait que j’ai souhaité mettre en exergue de ce texte, fut sans doute de produire un discours rationnel sur l’ensemble des éléments édifiant le contexte de vie humain. Au sein même de ses activités et de ses croyances, l’entreprise moderne sera venue mener un projet de « dévoilement », dont les conséquences trouvent actuellement leur point paroxystique dans ce que le philosophe allemand Byung-Chul Han nomme « La société de transparence »1. Le besoin de visibilité est aussi à l’origine de la multiplication du rôle du « médiateur », qui dans l’art comme ailleurs vient résoudre les petits drames du manque de compréhension. Une tendance artistique contemporaine, à laquelle l’exposition « Phainómenon » contribue, continue de se rendre irréductible à toute littéralité et à s’engouffrer dans des territoires plus complexes et subjectifs, où l’œuvre n’est pas une simple traduction, mais un objet traversé par les spectres intimes de l’expérience et de la croyance.
À la clarté aveuglante des grands récits qui n’émancipent plus, l’éclairage trouble d’engagement refusant les discours mystificateurs nous rappelle, dans le sillage de Susan Sontag, que « nous n’avons pas, en art, besoin d’une herméneutique, mais d’un éveil des sens. »2
Franck Balland
1 Byung-Chul Han, La société de transparence, PUF, Paris, 2017. L’auteur défend dans cet ouvrage un point de vue critique sur l’insistance contemporaine à rendre toute information accessible et lisible, qui selon-lui conduit à une société du contrôle permanent.
2 Susan Sontag, Contre l’interprétation, 1964
Critique d’art et commissaire d’exposition indépendant, Franck Balland a successivement travaillé à l’institut d’art contemporain de Villeurbanne, au Parc Saint Léger à Pougues-les-Eaux et à la galerie Marcelle Alix, Paris. De 2014 à 2017, il a co-dirigé Tlön, à Nevers, avec Jennifer Fréville.
> Télécharger le communiqué de presse <
Photographies: © Cécilia Philippe, 2018, © Aurélie Belair, 2018